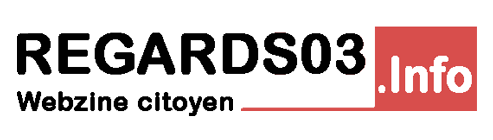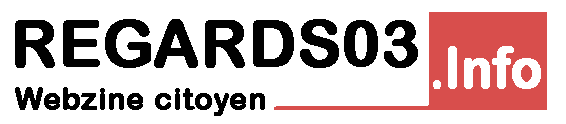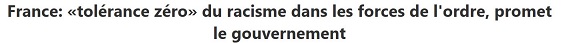Quelque part dans les Antimémoires, Malraux expose comment il projetait de bouleverser les méthodes d’enseignement en substituant l’image au discours. En tout cas, il n’y a peut-être pas de façon plus saisissante – au sens fort – de retracer l’histoire du racisme qu’en la montrant. A vrai dire, si l’image frappe, épouvante, si elle est le plus immédiat et décisif des révélateurs, si par elle la réalité saute aux yeux, prend à la gorge, laissant les mots loin derrière elle, elle ne se passe tout de même pas du commentaire. Ayant vu – et par quelle vision ! – on veut savoir : ou ? quand ? pourquoi ? Aussi le titre de Mme Elena de la Souchère est-il à la fois vrai et trop modeste. « Le racisme en mille images », sans doute. Mais ce film fascinant et horrible, il ne saurait se passer de sous-titres.
Et il s’agit, ici, de bien autre chose que de sous-titres : un texte qui occupe à peu près autant d’espace que l’image, et en caractères serrés dans des pages de grand format : bref, un livre. Je croirais volontiers non pas que l’auteur a commenté le film dont elle a dû choisir les images, mais que le film a été composé sur ce texte qui pourrait se suffire à lui-même. (Cursif, concis, dédaigneux de l’écriture, je ne lui reprocherai non certes la spontanéité familière dans l’émotion et l’indignation, mais un ton parfois trop lâché ; plus de rigueur entraînerait plus de force). Il reste qu’il colle étroitement aux images, et c’est là son originalité. A l’intérieur de chaque chapitre, les divisions sont marquées non par des mots mais par des chiffres : les numéros d’une suite d’images, et, au cours du développement, le lecteur est renvoyé, par le numéro entre parenthèses, à chacune de ces images. La lecture inverse est d’ailleurs possible, et on y recourra fréquemment : on déroule le film en se reportant, par le moyen de ces repères chiffrés, au paragraphe qui le commente.
A mesure qu’on feuillette l’ouvrage, on s’aperçoit ou on est confirmé dans ce qu’on croyait savoir : que l’histoire du racisme se confond avec l’Histoire tout court. Tout court est façon de parler, car c’est l’histoire même de l’humanité que Mme de la Souchère esquisse à travers l’affreuse aventure de la persécution et de la haine raciales. Elle prend cette histoire on ne peut plus tôt : dès la Genèse, où se manifestent, presque en même temps, l’origine commune de l’espèce humaine et sa division dans les trois grandes races, dont l’une opprimera et exploitera les deux autres, non sans que celles-ci se prennent à haïr et mépriser la première par des mouvements qui n’ont pas pour unique moteur cette oppression et cette exploitation.
L’historien a une autre raison de remontrer si haut : cette histoire des commencements, elle a été vécue et écrite par le peuple élu pour souffrir, et pour souffrir précisément la haine raciale la plus extraordinairement acharnée et constante qui ait jamais été nourrie par les hommes. Plus d’un lecteur découvrira peut-être cette partie, peu enseignée, de l’Histoire qui est celle de la persécution romaine et de la longue, héroïque résistance juive à Rome (ce qui n’est pas sans expliquer le christianisme) ; en compensation, pour l’honneur de l’humanité, point de haine ni de racisme chez les Grecs.
Avec l’Islam prend naissance un racisme religieux à double détente (on perd parfois de vue à quel point il fut réciproque), dont les Juifs seront doublement victimes. Puis l’histoire se détournera quelque peu d’Israël pour se fixer, avec la conquête du Nouveau Monde, sur un racisme de couleur qui est encore d’essence religieuse, bien que la religion soit déjà un beau manteau pour couvrir la rapacité. De toute façon, le fait économique, s’il n’exclut ni le fanatisme ni les réflexes viscéraux, bien au contraire, sera désormais le mobile profond du racisme : viennent donc les interminables chapitres de l’esclavage, de la colonisation, du colonialisme. Cependant, il devait être donné au XIXe siècle de couronner ces millénaires de haine raciale : de ce qui avait été, jusque-là produit par l’instinct, la peur, la superstition, l’intérêt, on fait soudain une doctrine et une pseudo-science. L’antisémitisme connaît alors une brusque virulence : pogroms russes, affaire Dreyfus, pour déboucher enfin sur le nazisme qui occupe, avec le racisme noir américain, tout le dernier tiers du livre. Implicitement ou explicitement, ce livre témoigne sur ce que racisme est le fruit naturel des régimes archaïques, réactionnaires et fascistes. Ce qui est vrai. Mais s’en tenir à cette vérité, n’est-ce pas se montrer, si l’on ose dire, trop optimiste ? Eliminer ces régimes, n’est-ce pas espérer s’en tirer à trop bon compte ? Les pogroms, invention typique de la Russie tsariste, sont ici éloquemment illustrés. L’objectivité, comme la mise en garde, n’exigeaient-elles pas fût-ce une seule image du racisme, voire de certaines formes d’un colonialisme soviétique ? De même, toute cette histoire est un réquisitoire écrasant contre l’homme blanc. Chacune de ces images dénonce, à travers les siècles des siècles, le racisme comme péché mortel de l’homme blanc. Mais n ést-ce point parce que, pour son malheur – et sa puissance et sa triste prospérité – il a été mis, et lui seul, en état de pécher ?
L’humanité puisse-t-elle être gardée des pécheurs de toute couleur ! Du reste, la plupart de ces mille images rappellent que c’est à l’intérieur de la race blanche que le racisme s’est le plus fréquemment et atrocement exercé. Et l’on ne peut guère douter qu’il n’infecte l’humanité tout entière. La couleur, les traits ethniques ne sont guère que des prétextes et des alibis pour assouvir la haine que l’homme porte l’homme. Qui oserait croire que si le nez de tous les hommes avait eu même forme et même longueur la face du monde eût été changée ? Elle ne peut l’être que par la conscience et la raison, exprimées dans la dernière image : la photographie de l’assemblée générale des Nations unies où fut proclamée la résolution sur, d’égalité universelle.
Ce n’est, du reste, – il faut le rappeler non pour le scepticisme mais pour la patience – que le principe même, et presque dans les mêmes termes, qu’avait proclamé la Révolution française.